Vie et Mort selon Mike Diana
Une imposante compilation en deux volumes du travail de Mike Diana, nommée America Live & Die vient d’être publiée par une obscure maison d’édition anglo-tchèque, Divus. 528 pages qui reprennent la plupart des planches de Diana jusqu’en 2011 et des reproductions de peinture. Elle était disponible sur le stand qu’occupait Divus au off d’angoulême en même temps qu’une exposition d’originaux dans une salle adjacente. Trouver autant de matériel sur Mike Diana étant rare et le pari de ce livre risqué. J’ai donc rapidement décidé d’acheter le coffret vendu une cinquantaine d’euros.
Le lecteur français a pu découvrir Mike Diana en 1995 dans La monstrueuse, fanzine édité par Stéphane Blanquet. Le style de Diana est ancré dans la mouvance underground de l’époque, ne dépareillant pas dans la liste des auteurs du fanzine, à côté de Français comme Paquito Bolino, Caroline Sury, Matt Conture, de Québécois comme Rick Trembles ou Henriette Valium. D’ailleurs aussi trash qu’aie pu être La Monstrueuse, le fanzine de Blanquet gagnera en 1996 le prix du fanzine d’Angoulême, alors nommé «Alph-art Fanzine». Pourtant, il est difficile de parler plus avant de Mike Diana sans revenir sur l’incroyable condamnation dont il a fait l’objet deux ans avant ce prix.
Obscénité et tragédie
Né en 1969 à New york, Mike Diana déménage à l’âge de 10 ans à Largo, en Floride. Il reçoit une solide éducation catholique mais dégoûté par les sermons sur la peur de finir en enfer, il arrête d’aller à l’église vers l’âge de 16 ans.
Il publie à l’école, en 1987, de courts récits dans lesquel ils met en scène le massacre sanguinaire des professeurs de son collège, distribués sous le manteau. Il lance l’année suivante ses fanzines HVUYIM, puis AngelFuck, avec un ami lui aussi originaire de New York, avec qui il partage une sainte haine de la Floride conservatrice. De 65 à 300 numéros, les fanzines se font connaître via le réseau le réseau de presse underground et se vendent surtout par la poste en dehors de l’État. En 1988 il est concierge dans une école primaire et en profite pour imprimer ses fanzines parlant de viol d’enfant, de mutilation et de drogue sur la photocopieuse de l’école. On retrouve des originaux oubliés sur place et il est viré.
En 1991, Diana est soupçonné dans l’affaire Gainsville, qui concernait le meurtre parfois accompagné de viol de cinq étudiants. Des scènes de violence dessinées par Diana sont considérées comme proches des circonstances des crimes non-élucidés. Lorsqu’une analyse ADN réalisée par le FBI l’innocente complètement, tout son dossier est transféré à Largo. Michael Flores, policier local, découvre alors horrifié quelques Boiled Angel de Diana. Se faisant passer pour un dessinateur de ‘zines fraîchement débarqué dans le coin, il commande par la poste le reste de la production de l’auteur. Diana se retrouve en 1992 convoqué au tribunal pour publication, distribution et publicité de matériel obscène.
Mike Diana défendra son travail pendant plus de trois heures durant le procès, mais se verra interdire le droit de montrer des comics comme ceux de Clay Wilson ou de Crumb comme pièces à conviction. Un psychiatre, comme dans les séries télé, viendra attester que les comics de Diana peuvent influencer des personnes déséquilibrées. Enfin, l’avocat de l’accusation insistera dans sa plaidoirie sur le fait que le comté de Pinellas a sa propre identité et n’a pas à accepter ce qui se passe aux bains de San-Francisco ou dans les ruelles dépravées de New York.
Diana est jeté en prison pendant les quatre jours d’attente de son verdict, ce qui n’arrive d’habitude qu’aux barons de la mafia, et sera condamné en 1995 à trois ans de probation, 3 000 dollars d’amende, 1248 heures de travaux d’intérêt général, l’interdiction d’approcher des mineurs à moins de 3 mètres, une surveillance psychiatrique et cours d’éthique en journalisme à ses frais et l’obligation de ses soumettre à des perquisitions sans mandat et à l’improviste par des policiers — et des agents de probation de l’Armée du salut — habilités à saisir tout écrit ou dessin.
L’affaire lui vaudra le soutien du milieu, de Neil Gaiman et Scott McCloud notamment, et de ligues de défense des droits constitutifs. Le Comic Book Legal Defense Fund interviendra à hauteur de 10 000 dollars dans ses frais de procédure. Malgré les nombreux recours, le jugement ne sera pas amendé. Diana s’exilera littéralement à New York et obtiendra de réaliser ses travaux d’intérêt général pour l’association American Civil Liberties Union.
Adult content
Impossible de faire abstraction du procès et de la condamnation de Diana, qui prennent un bon tiers de sa page wikipedia. C’est pourquoi il est bon qu’ait été publiée cette compilation chez Divus. Elle remet au centre la production de Diana, dont ont été retirées, par prudence probablement, les planches les plus violentes. Ainsi j’ai le souvenir d’un bébé pénétré par la fontanelle dont le crâne explose lors de l’éjaculation, récit dont on ne retrouvera pas trace ici.
America – Live & Die est un coffret composé de deux volumes. Live contient une compilation de planches et de dessins, Die une série de reproduction de peintures.
Passons rapidement sur Die. Diana commence à peindre alors qu’il est interdit de dessin, probablement un contournement de sa condamnation, et sa peinture travaille sur ses thématiques récurrentes sans plus-value picturale : verges en érection, membres coupés et pénétrations diverses, et quelques timides travaux sur les signes de l’Amérique sage, fillettes en jupe à pli regardant les tours jumelles s’embraser.
Live est bien le lieu vivant de l’œuvre de Diana, et ses planches le centre de sa production. On trouve dans cet opus de 400 pages d’assez classiques dessins underground au feutre noir. Son dessin appartient à cette famille large des «bad drawers». Chargé, gras dans ses traits, raide dans sa forme, ce n’est certainement pas un dessin virtuose, et si il produit son effet «d’écriture» — on peut reconnaître une planche de Mike Diana parmi d’autres productions de la même famille — le dessin de Diana ne semble jamais trouver une forme aboutie comme c’est le cas chez un John Porcellino par exemple.
Diana met en scène dans la plupart de ses récits des adolescents ouverts à toutes les expériences, des X-men déviants dans un monde sans Professeur Xavier ni Magneto. L’espace du récit est chez lui un espace amoral, et ses personnages répondent à la moindre de leurs impulsions. La prise de drogue, les propositions sexuelles les plus incongrues, les rencontres les plus étranges sont accueillies avec l’ingénuité de l’enfance et des organes sexuels d’adultes.
Pour ses personnages, n’importe quel aliment peut devenir drogue et faire partir en couille les situations. La différence entre réalisme et onirisme, déjà difficile, bascule alors le plus souvent dans l’horreur : des monstres jaillissent, les sexes atteignent des tailles hors proportions, les corps se transforment et ses personnages deviennent alors un danger pour les autres et eux-mêmes.
N’importe quelle personne rencontrée est un partenaire sexuel. Parents, frères, sœurs, amis, bébés, insectes et animaux, monstres et divinités sont disposés à pénétrer et être pénétrés. L’esthétique pornographique, dans laquelle toutes les situations quotidiennes sont immédiatement sexualisées, est certainement une des influences de sa bande dessinée. La pulsion sexuelle est juste, chez Diana, plus franchement connectée au reste de la psyché. N’importe quelle activité peut devenir une torture, celle-ci étant généralement le prolongement naturel d’une sexualité hors de contrôle.
School piss-hole
Ainsi, voici le synopsis de School piss-hole :
Un jeune homme se maudit d’avoir quitté l’école trop tôt avant de prendre les pilules expérimentales d’un test de laboratoire, qui est son job actuel. Les effets secondaires des pilules sont spectaculaires : il devient un géant au sexe turgescent, avec lequel il écrase le toit de l’école gardienne toute proche. Ses mains en forme de pinces pointues attrapent un enfant en fuite et il l’insère dans son urètre. La maîtresse d’école s’interpose et se fait écraser de manière sanglante d’un autre coup de pénis. Le cadavre de la maîtresse d’école est incrustée dans le pénis géant. Le jeune homme enfonce d’autres enfants dans son urêtre avant de les éjaculer au loin. Les effets des pilules se dissipent tandis que l’on peut entendre une voix appeler la police. Le jeune homme, redevenu physiquement normal et en plein descente, a un cadavre d’enfant dans les mains. Il pleure pour d’autres pilules.
Crier au fou
Dans la Floride des années 90, on peut imaginer que ce genre de récit passe mal. Et il est de bon ton ici de railler le conservatisme des USA, et de garder vivant l’espoir d’une Europe progressiste et ouverte. Mais dans la France qui précède le mandat de Copé comme président de la république, où l’on désire interdire dans les bibliothèques les récits posant les questions de genre et même les livres de Tomi Ungerer, la défense de l’œuvre de Diana pourrait bien redevenir un enjeu. Et malheureusement, la défense la plupart du temps adoptée pour ce genre de production m’emmerde. Elle passe la plupart du temps par l’argument «vive la liberté d’expression» ou une lecture du type «ce type a de sérieux problèmes psychologiques».
Passons rapidement sur la liberté d’expression : nous redoutons tous le moment — de plus en plus proche — où nous allons devoir défendre des auteurs, des proches, ou nous-mêmes, d’être «offensants», pour reprendre un terme à l’américaine. Nous serons alors sommés de défendre des œuvres et des personnes qui ne nous sont rien, comme en témoigne l’affaire Dieudonné. Cette défense devient rapidement hyperbolique et intenable. Disons simplement pour le moment qu’entre adultes consentants et en toute intelligence, nous négocions tous notre part d’ombre avec la société, et nous voulons que cette ombre puisse faire l’objet de débats et non de condamnations ou d’une camisole chimique.
Le vrai problème de Diana est la lecture psychologique. On ne peut pas nier qu’en lisant ses planches au marqueur baveux, on se dit que la frustration doit être immense — et je ne parle pas nécessairement de sexe.
Mais cette lecture a le tort d’ouvrir grand le tiroir du «Folk art» et d’y jeter tout ce qui dépasse. «Folk art» est une catégorie de l’art assez florissant aux États-Unis, avec ses artistes, ses galeries et son marché. On y trouve des statuettes pentecôtistes, du macramé et des figures comme Daniel Johnston. Pour un peu, Diana pourrait y être rangé aux côtés de Henry Darger, ce dessinateur mythique aux petites filles en jupettes roses munies de pénis tuées par des soldats en uniforme.
Le Folk art partage avec le rock et une partie de l’art le culte de l’authenticité. La nécessité irrépressible de créer, qui anime les artistes, leur permet de transcender les conventions en refusant les compromissions habituelles : autocensure, maîtrise des conventions académiques techniques et conceptuelles, carriérisme et lucre.
Cette vision romantique douteuse, assez commune, gomme plusieurs aspects décisifs d’une œuvre d’art. Ainsi, l’inscription de l’auteur dans l’histoire des productions artistiques, car l’usage de conventions artistique semble être un pur hasard. Ainsi, la maîtrise technique, puisque la pulsion n’est pas très compatible avec l’apprentissage. Elle nie enfin généralement la relation de l’auteur au public, les stratégies de médiation et de publicité, et la condition socio-professionnelle des artistes. La condescendance de cette approche vise à maintenir une bonne part du Folk Art dans une catégorie exotique de la culture, l’art de fou, et ainsi lui barrer le passage au débat de société. Un fou peut être un symptôme, mais il ne peut être partie prenante d’un débat.
Henry Darger est le bon client de cette vision de l’art : découvert après sa mort, son travail est l’itération d’une imagerie surannée dont il n’a pas la maîtrise. Le résultat est une production auto-centrée pure de toute intention mercantile. On explique généralement l’univers de Darger par son parcours personnel : sa mère morte en couche alors qu’il n’a que trois ans, le foyer violent où il est placé, la tornade dévastatrice dont il est témoin, etc.
Avec cette lecture, le médium disparaît. L’inconscient de l’auteur est tellement bouillonnant que ses productions sont l’expression brute de ses pulsions, immédiate, sans intermédiaire, donc. C’est très commode, car en l’absence de maîtrise consciente, le résultat peut donc être le message codé transmis d’inconscient à inconscient qui déclenche un mécanisme de passage à l’acte chez les esprits faibles et propices, dont parle le psychiatre du procès de Mike Diana. Ce genre de production doit donc être stoppée, cachée, ou détruite. CQFD.
Le travail de Diana réfute tout rapprochement avec le Folk art. Diana a une vision relativement froide de son travail et s’inscrit dans une histoire du comix assez ancienne. Les conventions de la bande dessinée sont présentes en grand nombre dans les planches de Live : cases, représentation iconique, itérativité, situations, obstacles, etc. Lors de son procès, Diana s’est défendu en invoquant ses influences graphiques et narratives dans l’histoire de son médium. Souvenons-nous à cette occasion qu’on se bourre déjà la gueule dans les planches de Rodolphe Topffer, datant des années 1820.
Pulsion Vs fiction
Pour faire pièce à cette réduction de la création une pulsion, il est impératif de voir l’œuvre de Mike Diana comme une fiction, une production artistique, c’est à dire un objet transactionnel, quelque chose qui a un public. Diana ne produit pas pour lui-même, il met en place des stratégies pour amener un public à son œuvre dès ses débuts, respectant la logique industrielle du médium bande dessinée, qui impose sa reproductibilité et sa distribution dans le processus même de création.
«Art can be ugly and convey a message.» dira-t-il lors de son procès. Si on voit ce travail comme une fiction, on peut alors le placer dans une autre famille, celle de Haneke avec son septième continent, de Lars Von Triers avec Les idiots et Nymphomaniac. Ou encore Larry Clark, Raymond Petibon, Mark Ryden ou Stéphane Blanquet, qui a été le premier à publier Diana dans Chacal puant.
Au delà d’un récit premier, toute fiction propose une vision du monde. C’est généralement elle qui nous intéresse. Ainsi, Game of Thrones, au-delà de tout ce que l’on peut raconter sur la psyché de ses personnages, nous dit : «Le pouvoir est générateur de tragédie, mais son exercice est la seule chose qui vaille la peine», ce qui est une vision du monde précise — et discutable. L’évocation de Game of Thrones n’est pas innocente, puisque cette série est un carton mondial, d’une part, et le porno soft et la violence que déploie la série sont généralement considérés comme salvateurs, car décloisonnant, interpellant, secouant le spectateur.
Diana n’est pas le sujet d’un délire intimiste pervers mais l’auteur d’un portrait grimaçant de l’Amérique, celle des petites villes conservatrices où l’on s’ennuie, avec sa capacité à déliter le rapport à autrui, et son tiraillement particulier entre individualisme et pression religieuse et communautaire.
Jouissance et altérité
Bien sûr, il y a dans les récits de Mike Diana une joie féroce de la transgression, mais pas celle de Jackass, le cascadeur de MTV qui nous rappelle à chaque épisode : «don’t do this at home». Ce que nous dit Diana, c’est que la violence est déjà à la maison. Il met en scène ce qui jamais ne pourra être exploité, des actes en désaccord profond avec tout ce qui pourra jamais exister de morale, dans n’importe quelle société. Cet impensable est restitué avec une des techniques les plus immédiates, un dessin maladroit au feutre baveux sur des feuilles de qualité médiocre. La bande dessinée peut être fière d’être le choix le plus évident pour ce travail, loin des sérigraphies de Hôpital Brut, loin de la peinture virtuose d’un Mark Ryden, du maniérisme de Joel-Peter Witkin et de Jake et Dino Chapman.
Bien sûr, Diana doit certainement jubiler en dessinant ces scènes atroces de joues taillées au couteau, mais probablement à peine plus que les scénaristes de la série fleuve Les Experts sommés d’inventer les crimes les plus sadiques et les dégâts corporels les plus détaillés à chaque épisode.
«Je ne dis pas que je comprends l’homme [hitler]. Ce n’est pas vraiment un brave type, mais (…) je compatis un peu avec lui. (…) Je pense qu’il a fait de mauvaises choses, absolument, mais je peux l’imaginer assis dans son bunker à la fin». Le tollé suscité par cette déclaration de Lars Von trier lors d’une conférence de presse à Cannes, qui lui vaudra de se faire jeter du festival, est ridicule. Tous les manuels d’écriture de scénario le disent : pour faire tenir un récit, il faut s’investir dans tous ses protagonistes. Et Bruno Bettelheim nous rappelle que l’enfant lisant les trois petits cochons se reconnaît dans le loup avant de se percevoir comme les trois petits cochons, les uns à la suite des autres.
Pourtant, les récits de Diana sont construit autour d’une forme de justice immanente. Aucun de ses crimes n’est impuni. La mort, la mutilation, la honte, l’expiation reprennent toujours ses personnages. Seule une lecture effrayée et superficielle peut donner à penser que Diana est un sociopathe, car il n’y a là aucune indifférence à la souffrance. Mike Diana sait ce que la plupart de ses contemporains font de leurs pensées les plus honteuses : ils prétendent simplement leur inexistence. Son travail d’artiste consiste à pointer du doigt une portion du réel en insistant : «always there, never seen» — toujours là, jamais vu.
Ce qu’il offre dans ses récits, ce n’est pas un rapprochement littéral à l’autre, cette douce sympathie que l’on peut retrouver dans un pan important des biographies et autobiographies contemporaines en bande dessinée, façon Les ignorants : «l’autre est un autre moi». Diana nous confronte, au delà de l’idiosyncrasie, à un endroit où presque personne n’est, à l’Autre dans ce qu’il a d’effrayant. La fascination que j’éprouve pour les récits de Mike Diana n’est pas la reconnaissance de mes propres désirs, la vision de mes cauchemars, mais précisément l’apparition d’un lointain, aussi proche soit-il. D’autres connexions y sont à l’œuvre qui rendent évidente l’existence d’un autre monde, et de son peuple irréductible.
 l’autre bande dessinée
l’autre bande dessinée


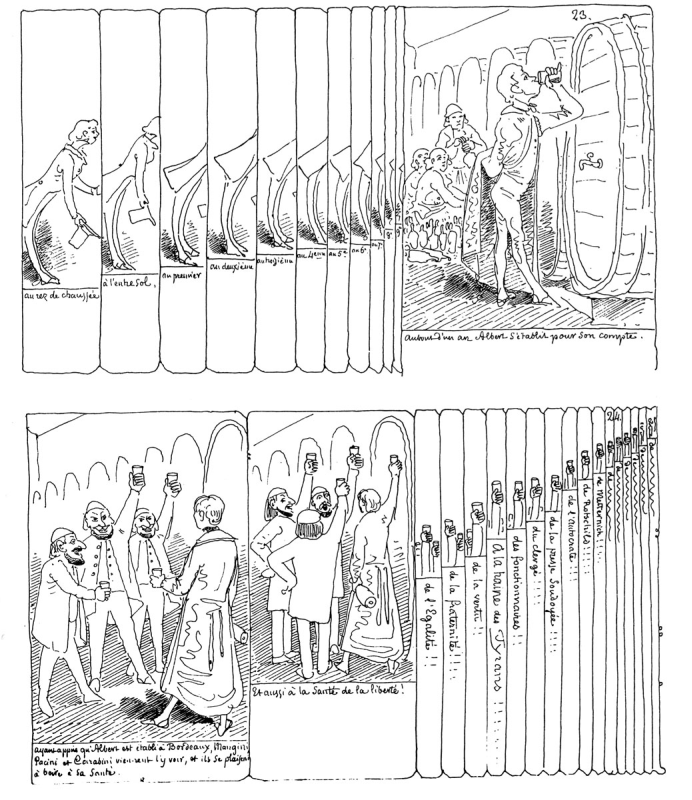

























An Ultimate Web-Hosting Solution For Business Owners https://ext-opp.com/HostsMaster